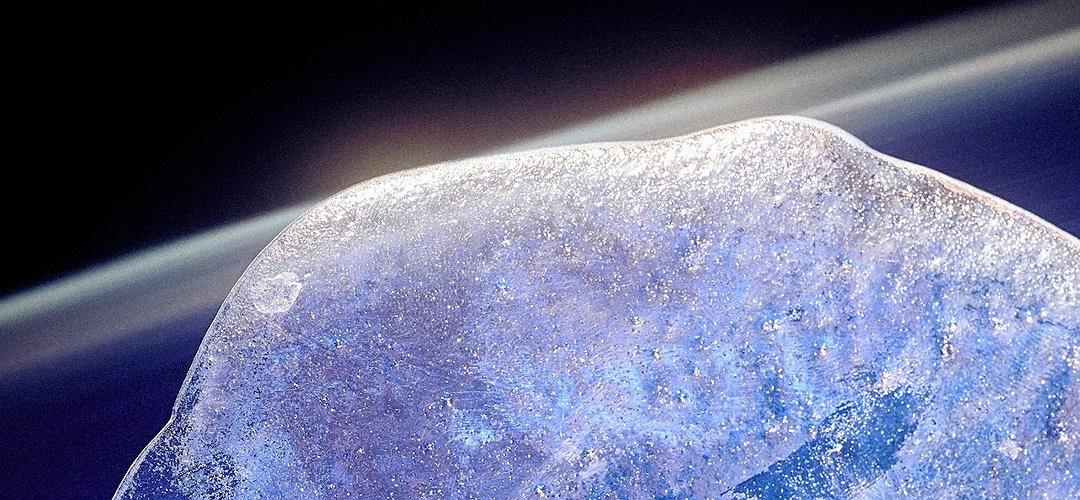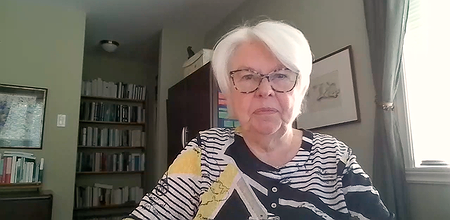Les psychologues ont un rôle majeur à jouer auprès des personnes qui entendent des voix ! Voici pourquoi :
- Cette expérience est très répandue chez la population clinique, mais aussi dans la population générale – une personne sur dix (Maijer et al., 2018).
- Beaucoup d’entre elles souhaitent recevoir un traitement psychologique (Berry et al., 2022; Longden et al., 2023).
- La médication antipsychotique n’améliore pas l’expérience d’entendre des voix pour une proportion relativement élevée – de 25 à 50 % (Newton et al., 2005) – et son emploi est lié à des effets secondaires importants (Berry et al., 2022). « ... les thérapies psychologiques offrent [donc] une forme de traitement plus sécuritaire et collaborative » (p. 2, traduction libre).
- Le fait que les voix – dans le nouveau paradigme qui veut qu’on en comprenne le sens – ne sont plus abordées strictement comme des symptômes, a permis de développer des approches thérapeutiques spécifiques aux voix (Hayward et al., 2015).
- Dans l’étude de Maijer et ses collègues, on a fait ressortir une prévalence plus élevée chez les enfants et les adolescents (12 %). Les psychologues, par leurs connaissances spécifiques, pourraient agir en amont pour prévenir la détérioration de l’état mental de jeunes qui entendent des voix.
- La regrettée Sandra Escher, dans son étude longitudinale auprès de jeunes qui entendent des voix, a mis en relief que le fait d’accepter l’expérience d’entendre des voix comme étant réelle et d’explorer les problèmes à la source de cette expérience (par exemple une situation d’intimidation à l’école) et en normalisant le fait qu’il n’est pas rare que les voix reflètent cette expérience, on s’assure que les jeunes accepteront davantage le phénomène et bénéficieront ainsi d’une aide psychologique. Ainsi, leur relation avec les voix change et leur développement n’est plus compromis (Escher et al., 2002; Escher, 2012).
- Il existe des questionnaires validés – ou des canevas d’entrevue – adaptés à leur âge pour faciliter la description de leur expérience (Escher, et al. 2011; Majier et al., 2019). Les enfants et les adolescents, ainsi que leurs parents et leurs enseignants, ont un besoin d’aide et d’information, de préférence par une approche globale et déstigmatisante (Hayward et al., 2025).
- Une expérience traumatique précède l’audition de voix tant chez la population clinique (Cameron et McGowan, 2013; Escher, 2012; Hayward, Strauss et Kingdon, 2018; Longden et al., 2023; Romme, 2012; Strachan, Paulik et McEvoy, 2024), que non clinique (Beaumiester et al., 2017; Honig et al., 1998).
- Les voix représentent différentes formes qui ont une fonction pour les entendeurs, ou en d’autres mots, ont une utilité selon la conceptualisation de la troisième vague de thérapies cognitives comportementales (Strauss, 2015).
- Toutes les fonctions des voix (critique, comminatoire, impérative[1], injurieuse, conseillère, humoristique, rassurante, prédictive, protectrice) peuvent nous aider à créer un « scénario » dans lequel les voix jouent divers rôles. Cela permet de tracer un tableau complexe des relations entre les différentes voix. Grâce à ce scénario on peut comprendre leurs sens, et ultimement, aider les personnes à reconnaitre qu’elles proviennent d’elles-mêmes (St-Onge, 2017).
- L’évitement du travail avec les voix chez les intervenants contribue à renforcer la stigmatisation et la subordination aux voix, renforçant ainsi la détresse des entendeurs (Cameron et McGowan, 2013).
- La théorie du rang social développée par l’équipe de Trower (2010) met l’accent sur le rôle des comportements de sécurisation et d’évitement dans le maintien, voire l’amplification des conséquences négatives des voix. Cette théorie postule que la détresse vécue par les personnes entendant des voix peut être expliquée par le type de relations qu’elles entretiennent avec les voix puissantes.
Dans ce contexte, la thérapie comportementale relationnelle a démontré qu’il est possible de changer une relation dominante avec les voix vers une relation plus affirmée et bienveillante. Les voix résultent parfois du fait que les entendeurs sont isolés. Ainsi les voix remplissent une fonction relationnelle – c’est-à-dire qu’elles sont utiles à briser cet isolement – lorsqu’ils n’ont pas accès à ces relations dans leur réseau (Hayward et al., 2011; 2021; Hayward et Paulik, 2015).
En conclusion, même si a priori les voix (et les délires qui y sont reliés) peuvent paraitre insensés (Kingdon et Turkington, 2005), contrairement à une croyance populaire, ces manifestations sont reliées à des expériences passées; elles ne sont donc pas en discontinuité de l’expérience (Beaumiester et al., 2017) et il est possible d’en construire le sens pour pouvoir les remettre en question et s’affranchir de leur pouvoir. Dans le nouveau paradigme, on invite les professionnels de toutes les disciplines de la relation d’aide, incluant bien sûr les psychologues, je dirais au premier chef, à s’ouvrir à la possibilité d’intervenir auprès des personnes qui entendent des voix et à développer des alliances avec elles pour les aider à sortir de leur isolement.
[1] Cette forme de voix pourrait conduire à une intervention immédiate si elle commandait à la personne de se tuer ou de tuer quelqu’un de son entourage. Comme c’est le cas pour une personne qui présente un risque suicidaire élevé, on peut recourir aux outils concernant le risque de passage à l’acte. Si le risque est imminent, cela requiert une urgence psychiatrique (voir St-Onge, 2017, p. 36-39, pour une description des fonctions des voix). Un guide thérapeutique a d’ailleurs été publié pour travailler avec ce type de voix impératives (Meaden et al., 2013).
Références bibliographiques
Beaumiester, D., Sedwick, O. Howes, O. et Peters, E. (2017). Auditory verbal hallucinations and continuum models of psychosis: A systematic review of the healthy voice-hearer literature. Clinical Psychological Review, 51, 125-141. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2016.10.010
Berry, C., Baloc, A.-I., Fowler, D., Jones, A.-M., Hazell, C.M. et Hayward, M. (2022). The psychological therapy preferences of patients who hear voices. Psychosis. https://doi.10.1080/17522439.2022.2095000
Cameron, D. et McGowan, P. (2013). The mental health social worker as a transitional participant: Actively listening to ‘voices’ and getting into the recovery position. Journal of Social Work Practice, 27(1), 21-32. https://doi.org/10.1080/02650533.2012.732047
Escher, S. (2012). Hearing voices in children. The message of the voices. Dans M. Romme et S. Escher (dir.), Psychosis as a personal crisis: An experience-based approach (p. 104-115). Routledge, The International Society for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychosis.
Escher, S., Hage, P. et Romme, M. (2011). The Maastricht Interview. http://www.hearingvoices.org.nz/index.php/helpful-pamphlets-and-information-sheets/59-the-maastricht-interview
Escher, S., Romme, M., Buiks, A., Delespaul, P. et Van Os, J. (2002). Independent course of childhood auditory hallucinations: A sequential 3-year follow-up study. British Journal of Psychiatry, 181(suppl. 43), s10-s18. https://doi.10.1192/bjp.181.43.s10
Hayward, M., Berry, K. et Ashton, A. (2011). Applying interpersonal theories to the understanding of and therapy for auditory hallucinations: A review of the literature and directions for further research. Clinical Psychology Review, 31, 1313-1323. https://doi.10.1016/j.cpr.2011.09.001
Hayward, M., Evenden, S. et Culham, A. (2021). Relating therapy for voices: Learning how to respond assertively in difficult relationships. Dans I. Parker, J. Schnackenberg et M. Hopfenbeck (dir.), The practical handbook of hearing voices. Therapeutic and creative approaches (p. 246-255). PCCS Books.
Hayward, M., John, M., Parry, S., Bibby-Jones, A.-M., Orchard, F., Malpass, F., Dixon, C. et Naito, A. (2025). Support for young people who are distressed by hearing voices: Protocol for an uncontrolled feasibility evaluation of a psychological intervention package delivered within secondary schools (the ECHOS study). Pilot and Feasibility Studies, 11(1), Article 39. Advance online publication. https://doi.org/10.1186/s40814-025-01611-x
Hayward, M. et Paulik, G. (2015). What have we learnt about relational approaches? Dans M. Hayward, C. Strauss et S. McCarthy-Jones (dir.), Psychological approaches to understanding and treating auditory hallucinations: From theory to therapy (p. 129-150). Routledge.
Hayward, M., Strauss, C. et Mc-Carthy-Jones S. (2015) (dir.). Psychological approaches to understanding and treating auditory hallucinations: From theory to therapy. Routledge.
Hayward, M., Strauss, C. et Kingdon, D.G. (2018). Overcoming distressing voices: A self-help guide using cognitive behavioral techniques (2e éd.). Robinson.
Honig, A., Romme, M., Ensink, B., Escher, S., Pennings, M. et Devries, M.W. (1998). Auditory hallucinations: A comparison between patients and nonpatients. Journal of Nervous and Mental Disease, 186(10), 646-651. https://doi.org/10.1097/00005053-199810000-00009
Kingdon, D.G. et Turkington, D. (2005). Cognitive therapy of schizophrenia. Guilford Guides to Individualized Evidence-Based Treatment Series.
Longden, E., Branitsky, A., Sheaves, B, Chauhan, N. et Morrison, A. (2023). Preferred treatment outcomes in psychological therapy for voices: A comparison of staff and service-user perspectives. Psychosis, 1-11. https://doi.org/10.1080/17522439.2023.2215298
Maijer, K., Begemann, M.J.H, Palmen, S., Leucht, S. et Sommer, I.E.C. (2018). Auditory hallucinations across the lifespan: A systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 48(6), 879-888. https://doi.org.10.1017/S0033291717002367
Maijer, K., Hayward, M., Fernyhough, C., Calkins, M.E., Debbané, M. Jardri, R., Kelleher, I. Raballo, A., Rammou, A. … (2019). Hallucinations in children and adolescents: An updated review and practical recommendations for clinicians. Schizophrenia Bulletin, 45(Suppl. 1), S5-S23. https://doi.org/10.1093/schbul/sby119
Meaden, A., Keen, N. Aston, R., Barton, K. et Bucci, S. (2013). Cognitive therapy for command hallucinations: An advanced practical companion. Routledge.
Newton, E., Landau, S., Smith, P., Monks, P., Shergill, S. et Wykes, T. (2005). Early psychological intervention for auditory hallucinations: An exploratory study of young people’s voices groups. Journal of Nervous and Mental Disorders, 193, 58-61. https://doi.org/10.1097/01.nmd.0000149220.91667.fa
Romme, M. (2012). Accepting and making sense of voices. A recovery-focused therapy plan. Dans M. Romme et S. Escher (dir.), Psychosis as a personal crisis: An experience-based approach (p. 153-165). Routledge, The International Society for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychosis.
St-Onge, M., avec la collaboration de B. Ngo Nkouth (2017). Entendre des voix : à la recherche de sens. Éditions Santé mentale et société, coll. À l’affut.
Strachan, L.P., Paulik, G. et McEvoy, P.M. (2025). The trauma-related voices model: An integration of auditory verbal hallucinations and posttraumatic stress. Clinical Psychology and Psychotherapy, 1-15. https://doi.org/10.1002/cpp.70024
Strauss, C. (2015). What have we learnt about mindfulness-based interventions and acceptance and commitment therapy for distressing voices? Dans M. Hayward, C. Strauss et S. McCarthy-Jones (dir.). Psychological approaches to understanding and treating auditory hallucinations: from theory to therapy (p. 151-169). Routledge.
Trower, P., Birchwood, M. et Meaden, A. (2010). Appraisals: Voices’ power and purpose. Dans F. Larøi et A. Aleman (dir.), Hallucinations. A guide to treatment and management (p. 81-101). Oxford University Press.